LA VIE AU 4 RUE FROIDEVAUX
|
| Navigation : Lapicque/Sources d'inspiration/Le 4 rue Froidevaux. |
| Entrons un moment dans l'intimité des habitants de cet immeuble du 4 rue Froidevaux (Paris 14ème), grâce à un magnifique texte écrit par son fils ainé Georges en février 2009. Let's enter Lapicque's family intimity for a while, in his parisian house located 4 Froidevaux street, thanks to a beautiful text, written by his elder son Georges, in Feb. 2009. English version coming soon. |
Charles Lapicque et la rue Froidevaux |
||
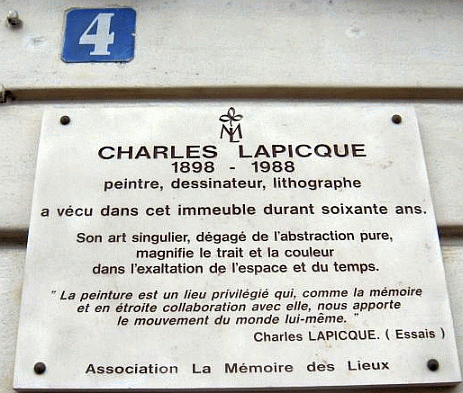 |
Un passant attentif aux hommes célèbres ne peut manquer une grande plaque au numéro quatre de la rue Froidevaux, face au Sud, donnant sur le petit jardin situé à quelques centaine de mètres du célèbre Lion de Belfort. Cette plaque (ci-contre) indique que le peintre Charles Lapicque a vécu ici soixante années de sa vie. Elle est suivie d'une citation de ses pensées sur la peinture et l'art, déjà évoquée. C'est, sans doute, l'un des plus beaux témoignages des maisons de Paris, et il mériterait d'être complété. En effet, cette maison a abrité bien d'autres personnalités, à l'époque plus célèbres que mon père : Francis Perrin, futur haut commissaire à l'énergie atomique et fils du prix Nobel de physique, Jean Perrin (pour la mesure du nombre d'Avogadro et la démonstration de la réalité atomique), Emile Borel, célèbre mathématicien de la théorie des probabilités et ministre de la Marine des années 1925, Frédéric Joliot et sa femme Irène Curie, suivis après la dernière guerre, par leurs enfants, à leur tour scientifiques. A tout ce fourmillement de personnages hors série s'ajoutaient leurs amis, à tel point que l'on pourrait voir dans cette maison l'équivalent, pendant l'hiver, de ce domaine estival, dont la presse a fait mention sous le nom de « Sorbonne plage », ou même « Fort la Science ». On peut ajouter que la densité de prix Nobel était de trois (ici rapportés à la surface d'un appartement), chaque fois que mon grand père Jean Perrin passait par là. |
|
Quelle fut l'origine de cette maison ? Longtemps, je l'ignorai, comme tout mon entourage. Ce fut ma tante Colette, sœur du grand physicien Pierre Auger et femme de Francis Perrin, qui m'expliqua, peu avant sa mort, que c'était Emile Borel qu'il fallait remercier : Les choses en seraient restées là sans le prix Nobel, immense bain d'oxygène pour mon grand- père, jusque là simple chercheur. En 1927, il faisait non seulement construire Ty Yann en Bretagne, mais donnait à son fils Francis, le sixième étage et à Charles Lapicque le quatrième étage, achetés à son ami. Voilà pourquoi mes parents quittèrent alors le petit appartement du boulevard du Montparnasse, face à la gare, pour s'installer rue Froidevaux. Ce fut le début l'histoire de cette rue dans nos vies. Mes parents n'habitèrent longtemps que la partie « gauche » de l'étage, que j'appelai « du côté de chez Aline », mon père n'ayant eu pour son travail qu'une, puis deux pièces sur la rue, puis, après la libération, l'ensemble de l'appartement de « droite », que j'appelai « du côté de chez Charles ». Cette division, quelque peu réductrice, n'a jamais empêché la cohabitation, des parents, de leurs enfants et de leur famille dans un espace tout de même restreint (mon père occupant, dans la partie de droite, les deux pièces de travail et une de souvent stockage)… Il paraît que nous avons été jusqu'à onze à habiter là, vers les années 1958. J'allais oublier : il y avait deux chambres « de bonne » au septième. Elles furent fort utiles pendant l'occupation pour loger des aviateurs anglais et des juifs. Ma mère, avant de s'engager plus avant dans la Résistance, avait demandé à mon père s'il était d'accord. « Si je ne l'étais pas, je ne pourrais plus me regarder dans un miroir » avait-t- il répondu. A mon retour en France, après avoir fait la guerre dans la Marine de la France Libre, sans doute moins dangereusement qu'eux, j'en ai frémi en les félicitant. La vie de mes parents, tous deux peintres, se déroulait très simplement. Ma mère, dont mon père admirait le grand talent, au point de regretter publiquement qu'elle fît trop de politique (ce qu'elle faisait par idéal et générosité), peignait uniquement par plaisir. Elle faisait de merveilleux paysages, principalement en Bretagne, et à Paris des portraits, qui, encore aujourd'hui, gardent toute leur fraîcheur. Elle savait faire ressortir l'âme autant que les grands maîtres, et avec plus d'ambition, eût été connue. Elle préférait être simplement heureuse au milieu de sa famille et de ses enfants, occupation qu'elle doublait par de fréquentes visites chez des amies, pour un thé le plus souvent (notre milieu était très anglophile). La nourriture était fort simple, à base de pommes de terre, parfois au lait ribot pour mon père de boudin ou de hareng : aussi, n'avons-nous jamais été difficiles. Le Dimanche, c'était le jour d'invitation chez Jean et Mimi (les grands parents maternels :Jean et Henriette Perrin). Mimi faisait très bien le couscous, ayant passé une partie de son enfance en Algérie, où son père avait construit le chemin de fer. Parfois, nous étions invités à déjeuner chez l'Oncle Louis, rue Soufflot, dans son appartement très Napoléon trois, qui cadrait si bien avec la Tante Marcelle, nièce du poète de Hérédia et remarquable pianiste. L'atmosphère y était intime, affectueuse et quelque peu solennelle. Le chauffeur s'appelait « monsieur Jean » et la cuisinière, qui faisait si bien les gâteaux à la purée de marrons arrosée de crème de chocolat chaud, s'appelait Célestine. L'oncle Louis était un spécialiste en vins de Bourgogne et de la vallée du Rhône … un de ses vins préférés se trouvait-être, en opposition avec ses convictions religieuses, le château neuf du pape . Après la libération, la vie s'étant organisée : on déjeunait (évidemment) du côté de chez Aline. Mon père venait, à côté de son atelier de peinture, sensiblement de 12 h. 30 à 14h. 30. On parlait de tout sauf de peinture (selon le cas, de tennis, de voile, de souvenirs divers…). Après le déjeuner, on jouait de la musique, mon père au piano, mon frère François à la trompette et moi au violon (quand nous étions là). C'étaient toujours des airs de la « Flûte enchantée », ou d'opéras de Haendel. L'immeuble étant mal insonorisé, nous étions écoutés par les oreilles bienveillantes (heureusement) de nos amis Combrisson au troisième (lui ancien hautboïste et elle ancienne violoniste) et du premier flûtiste à l'opéra, Lucien Lavaillotte, au cinquième. Il y avait parfois des dîners pour recevoir telle ou telle personne intéressante. Détail piquant : Mes parents ne buvant couramment que de l'eau, le carton de vin blanc que mon père recevait pour le nouvel an, était le plus souvent pratiquement intact à la fin de l'année. Cet état désolant fut, heureusement interrompu vers les années cinquante par l'arrivée de ma femme, dont le père représentait des grandes marques aux Antilles. Voyant cela avec intérêt, mon père ne tarda pas à la charger de tout ce qui tenait à la table, chaque fois qu'il recevait. C'est ainsi qu'il put honorer à sa juste valeur le futur commissaire général de la Marine Hillairet, son premier client, à qui il devait d'être peintre de la Marine. Il ne faut pas oublier que la plupart des réceptions avaient lieu chez Jean Perrin, dans la belle maison du No 6 de la rue du val de Grâce, ancien hôtel particulier de Mlle de Sévigné, ce lieu romantique de recueillement et d'amitié. On y retrouvait le plus souvent les amis et amies du savant autour de cette figure inoubliable qui, au cours de nuits maintenant historiques, dans le laboratoire voisin de la rue Pierre Curie, avait pu calculer, loin des vibrations des automobiles, à partir de l'étude de solutions de gomme gouttes, la valeur du célèbre nombre d'Avogadro. Je me souviens avoir déjeuné là, pour la dernière fois, venant de Cherbourg où je préparais l'Ecole Navale, à Pâques 1940. Mon père était venu en permission depuis Toulouse avec Antoine de St Exupéry, avec qui il faisait des vols d'observation de camouflage autour des villes. St Exupéry avait parlé avec admiration de l'Amérique. A la fin du repas, mon grand père, ce Victor Hugo de la science, s'était levé pour dire quelques mots d'admiration au célèbre pilote et romancier. Lui seul savait parler avec cette éloquence ! De lui, mon père disait qu'il n'avait jamais réussi à payer l'addition avant lui quand ils allaient au restaurant. Il était connu, aussi pour ses tours de cartes remarquables. Mais c'étaient les dîners des soirs de fête qui étaient les plus mémorables. La table de la rue Froidevaux s'ornait alors d'une nappe en remplacement de la toile cirée, et s'entourait d'un petit groupe d'amis provenant le plus souvent de l'immeuble, notamment pour Noël ou le 31 Décembre. Il y eut ainsi, à partir des années soixante, et pour citer les plus vénérables pour moi, les Maurain (le doyen de la faculté des sciences et sa femme, Jeanne, remarquable angliciste, quoiqu'agrégée de mathématiques) ainsi qu'Emile et Marguerite Borel. Il fallait la valeur de ces femmes pour rétablir un équilibre nécessaire dans la conversation, toujours animée et gaie. Emile Borel était célèbre pour son art de savoir partir : A minuit « pile », il se levait et disait : « Mes amis, si j'étais chez moi (en fait, c'était deux étages en dessous), j'irais me coucher ! ». Le départ était donné. Mon père pouvait alors s'adonner à sa passion de la musique, ce qui était toujours le cas après les dîners de famille sans invités. On écoutait alors, selon le temps qui restait, la passion selon St Mathieu, la passion selon St Jean, l'oratorio de Noël le Magnificat, l'ode à la Ste Cécile, le Messie. Assez typiquement, ce n'était jamais, à cette occasion, un opéra, même le Flûte enchantée , qu'il aimait tant. Il y avait les jours courants et les jours de fête. Pour ceux là, c'était, en tout cas pour les réunions de fin d'année, le caractère sacré qui dominait, et pour lequel, seule la Flûte aurait été appropriée. Voilà les quelques souvenirs que j'ai pu retrouver autour de ces maisons qui ont bercé mon enfance, parmi ces grands hommes, sans avoir conscience de la chance exceptionnelle qui était la mienne. Si j'en fais état aujourd'hui c'est par devoir d'en rendre compte et d'indiquer dans quel cadre a évolué mon père Charles Lapicque, sachant que cet homme exceptionnel ne peut être isolé de son œuvre, dont le caractère d'invention perpétuelle peut être rapproché, dans le domaine de l'Art, de celui de la Science qui l'avait formé, mais ne lui suffisait pas. |
||
| voir aussi : Lapicque et le tennis Lapicque et la mer Lapicque et la musique Lapicque et la Marine |
Georges Lapicque, fils aîné du peintre © Tous droits réservés 2007 |
|
NOTA : Georges LAPICQUE, ancien officier de Marine (Ecole Navale 1941-Londres-) puis ingénieur chercheur au Commissariat à l'Energie Atomique, est, sous le nom de Jean de Lost-Pic, auteur de six recueils de poésie de forme classique. Il est président de l'Académie de la Poésie Française, directeur littéraire de la revue trimestrielle l'ALBATROS (Ed. ARCAM PARIS). Accédez à son site |
||
| écrivez-moi (send me an e-mail) | ||